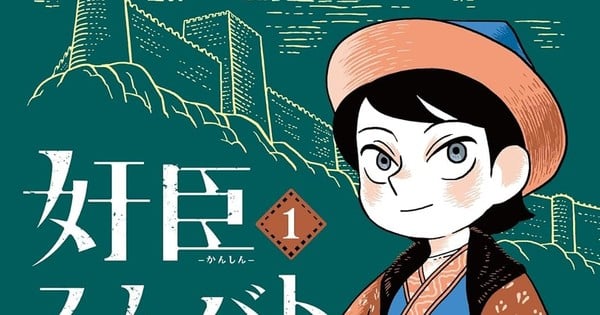Les exportations de farines françaises ont chuté de 90% en 30 ans. La fillière souffre d’un manque d’investissements et d’un manque de compétitivité. À l’inverse, la production allemande a le vent en poupe et peut compter sur un obvious nombre d’avantages.
La farine française ne fait plus recette. En 2024, l’Hexagone n’a exporté que 214.000 tonnes de farine, contre 1,6 million en 1995, une chute de 90% en 30 ans. Jusqu’à voir sa balance commerciale s’inverser.
“Du rang de premier pays exportateur, la France est devenue un importateur net de farine depuis 2018”, regrette l’Association nationale de la meunerie française (ANMF).
Une dégringolade qui s’explique notamment par l’émergence de nouveaux acteurs. “Cette chute sur les marchés mondiaux vient en partie du fait que nombre de pays africains se sont équipés de moulins et écrasent du blé importé brut, explique Anne-Céline Contamine, secrétaire générale de l’ANMF, à l’Opinion.
Et si la France se distingue et accélère désormais sur les segments haut de gamme et exporte de plus en plus aux États-Unis, cela ne suffit pas à porter la filière.
“Un déficit industrial historique”
Les difficultés du secteur, conjugués à l’augmentation des prix du blé avec la guerre en Ukraine, ont eu raison des Grands Moulins de Strasbourg (4e meunier français) en 2023.
Au pays de la baguette, la farine est de plus en plus importée. Les importations ont atteint 400.000 tonnes en 2024, soit presque 10% des besoins. “Un déficit industrial historique” selon l’ANMF. La France se fournit notamment auprès de l’Allemagne, pour 60% de ses importations (elles ont doublé en 10 ans).
La farine allemande prend de plus en plus de place, notamment dans les rayons des supermarchés, avec 25% des sachets de 1kg vendus en grandes surfaces, souvent des premiers prix.
“Cette fraction ne cesse de croître, portée par des offres de prix très compétitives”, explique l’ANMF.
Une filière allemande plus compétitive
L’association a même décidé de prendre le sujet à bras de corps et de réaliser une étude sur la différence de compétitivité entre la France et l’Allemagne. Premier constat: le taux d’extraction de la farine se situe en moyenne à 81% sur les cinq dernières années en Allemagne, contre 78% en France. Ce qui s’explique à la fois par la performance de l’équipement et par les spécificités du blé utilisé.
Par ailleurs, les moulins allemands, en plus d’avoir une grande capacité, sont intégrés dans des groupes ayant une diversité d’activités. “Cette organisation, qui mutualise certaines fonctions de l’entreprise, favorise la réalisation d’économie d’échelle avec une réduction des prices de production”, détaille l’ANMF.
Enfin, la filière allemande profite de coûts moins élevés, notamment parce qu’elle emploie moins d’effectifs par rapport à la taille des moulins. L’étude évoque aussi les coûts de production qui sont plus faibles: coût de revient du blé, salaires, taxes… Ce qui lui permet d’être d’être compétitive sur les prix.
“Vieillissement de l’outil de production”
Ironie du sort: la farine allemande est souvent faite avec du blé français, écrasé de l’autre côté de la frontière, puis renvoyé dans les supermarchés français. L’ANMF dénonce même le fait que certains sachets de farine fabriqués en Allemagne arborent des drapeaux français ou mettent en avant l’origine française du blé, même si la transformation se fait de l’autre côté du Rhin.
“Cette pratique entretient une confusion auprès des consommateurs, qui pensent acheter un produit intégralement français.”
Dans ce contexte, l’ANMF appelle à plus de transparence et surtout à des investissements dans le matériel (digitalisation, modernisation) et des locaux de stockage (agrandissement, adaptation). Mais dans un contexte de marges très réduites, les entreprises n’ont souvent pas les moyens d’investir.
Un rapport du Crédit Agricole sur le secteur pointe le “vieillissement de l’outil de production” et “des projets d’investissement continuellement ajournés”. Ainsi, selon un sondage auprès des entreprises, en 2024, 55% ne prévoient pas de hausse dans leurs investissements. Près 20% devront même opérer des coupes dans leurs dépenses de travaux. La faiblesse de la rentabilité est la principale raison mise en avant (57% des réponses).




/https://sportsmole-media-prod.s3.gra.io.cloud.ovh.net/uploads/2025/07/aryna-sabalenka-in-action-at-wimbledon-on-june-30-2025-6863e3d240b2a297286491.jpg)